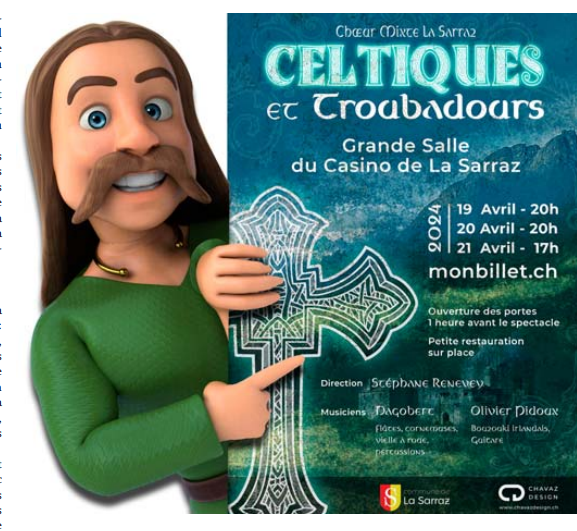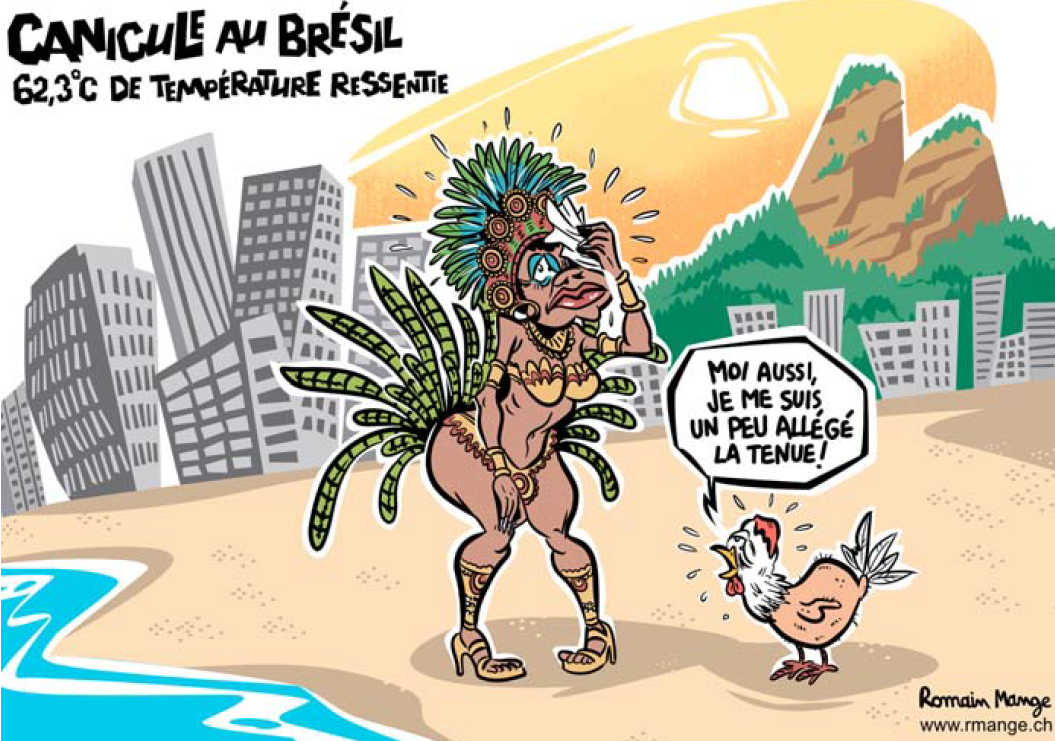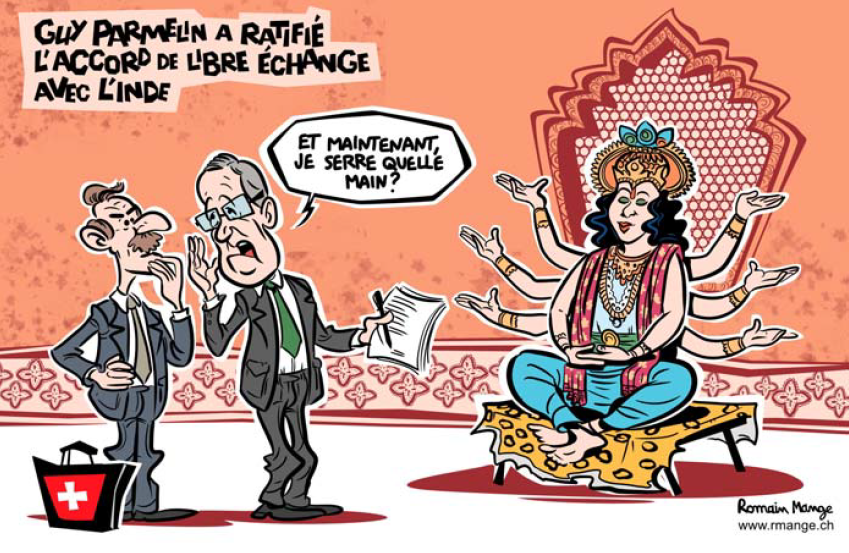Entre les deux photos de cet édito, un mois a passé, mais un mois pas comme les autres. Un mois où le «moi normal qui vit dans une société» s’est arrêté. Un mois où l’on a été contraint de faire comme tout le monde, où tout ce qui constitue l’essence même de notre humanité – le contact, l’échange, la proximité – a été rangé au placard. Comme si l’on pouvait tout déconnecter d’un coup.
Eh bien, on a pu.
En terminant l’édition du numéro du 25 mars, j’ai décidé, pour la première fois de ma vie, de ne pas me raser jusqu’au numéro du 24 avril, puisqu’entretemps notre journal a dû cesser sa parution durant trois semaines (chute vertigineuse des recettes publicitaires et de la matière rédactionnelle).
Derrière ce petit défi de rien du tout, il y avait une symbolique. Oui, le temps a passé et oui la barbe a poussé. Cela signifiait pour moi que l’on était dans la salle d’attente de la vie et que cette existence vécue entre parenthèses n’est pas celle qui est faite pour l’humain.
Par conséquent, au moment où notre hebdomadaire reprend du service, je vais me débarrasser vite fait de cet accessoire pilifère. Ça y est, je considère que je suis sorti de la salle d’attente et que désormais, il va falloir reconstruire les chemins vers notre vie réelle. Bien sûr, je vais suivre les recommandations qui seront édictées par le Conseil fédéral, mais je ne vais pas participer au commentaire de cette sortie par étape du confinement. Pourquoi? Parce que notre société y est entrée ensemble dans ce confinement et que, désormais, il faut qu’on en sorte ensemble. Si chacun de nous y va de son propre avis, ce sera (ou peut-être est-ce même déjà) une vaste cacophonie. Ne nous en faisons pas, l’ère du «moi-je» a encore de beaux jours devant elle. Donc d’ici au 8 juin, jouons collectif.
Alors, bien sûr, on va entendre des voix (ou peut-être les entend-on déjà) qui vont dire: «C’est risqué». Oui, c’est risqué, mais ne rien risquer équivaut à risquer encore davantage! Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que la vie est risquée, elle l’a été avant le COVID-19, elle le sera encore longtemps après que l’on aura trouvé une parade contre ce satané virus. L’écrivain français Marcel Pagnol disait: «Si vous voulez aller sur la mer, sans aucun risque de chavirer, alors, n’achetez pas un bateau: achetez une île!»
Risquons donc, en confiance et en appliquant les mesures de sécurité, un retour à notre vie ordinaire (en n’oubliant pas que 80 à 85% des gens qui vont contracter le virus dès le 27 avril souffriront d’une forme bénigne de la maladie, voire n’auront aucun symptôme).
Parce qu’à trop vouloir protéger les plus fragiles, nos aînés, nous avons érigé une forme de prison invisible entre eux et nous. Une visioconférence ne remplacera jamais le câlin d’une grand-maman à ses petits-enfants. Et le manque de tendresse, de contact humain est une souffrance qui tue davantage à mes yeux. «Les caresses sont aussi nécessaires à la vie des sentiments que les feuilles le sont aux arbres. Sans elles, l’amour meurt par la racine ». Ce mot de l’écrivain américain Nathaniel Hawthorne, je le fais mien à l’issue de cet édito.
Faisons-nous confiance, continuons d’être responsables et retournons peu à peu à notre seul destin qui vaille, celui de vivre libre.
Pascal Pellegrino, rédacteur en chef,
ppellegrino@journalcossonay.ch